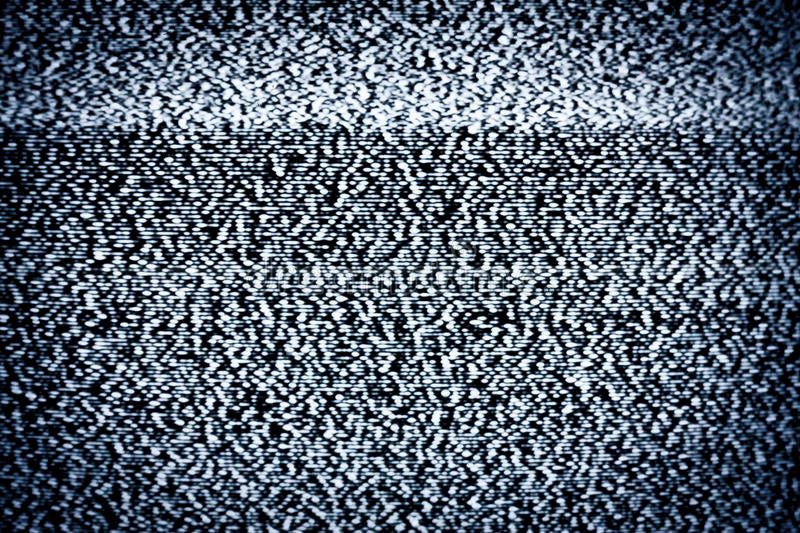Pornhub, après: «C’était tellement une bombe à retardement.»
On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Mais qu’en est-il lorsque ces intentions ne le sont pas?
Texte par: Natalia Wysocka
«The Fight to Hold Pornhub Accountable» titrait le New Yorker le 13 juin.
Le New Yorker, média respecté, connu pour sa rigueur et pour son sérieux, aurait assurément un éclairage neuf et perçant sur cette histoire qui secoue depuis décembre 2020 la compagnie détenue par MindGeek. Non?
Après quelques paragraphes décrivant des situations d’exploitation horribles, consternation: qu’est-ce que Laila Mickelwait fait là? Interviewée sans confrontation, la militante américaine qui mène vigoureusement la campagne TraffickingHub visant à faire fermer Pornhub, qu’elle qualifie de «site super prédateur» mené par des «cadres méga proxénètes», reçoit du New Yorker une tribune sur un plateau d’argent.
Dans un paragraphe, Mickelwait, une femme décriée de partout - par des défenseurs de droits LGBTQ+, par des personnes de l’industrie pour adultes, et même par des victimes qu’elle prétendait «défendre» et qui affirment avoir été instrumentalisées par elle - est pourtant présentée, simplement, comme une passionnée de la prévention. «C’est fantastique quand on peut sortir quelqu’un de l’exploitation, mais ce serait mieux s’il ne s’y retrouvait pas au départ.»
Le mot documentaire est ensuite utilisé sans ironie par la journaliste du New Yorker, Sheelah Kolhatkar, pour décrire Nefarious: Merchant of Souls, un film que Laila Mickelwait a promu hardiment à travers le monde alors qu’elle était «directrice de l’abolition» au sein de l’organisme Exodus Cry.
Ce condensé de statistiques erronées, de préjugés, de mises en scène bancales et de chiffres non-vérifiés offre des solutions pour soi-disant combattre le trafic humain. À savoir: Prier. Et donner de l’argent à un organisme qui prétend combattre le trafic humain. Le tout se termine par la confession du réalisateur, Benjamin Nolot, qui dit regretter de ne pas avoir réussi à «secourir des filles enfermées dans des cages».
Que le New Yorker ait même cité un tel long métrage est en soi stupéfiant. Qu’il n’ait pas confronté Laila Mickelwait sur tant de choses l’est d’autant plus. Par exemple, sur le «village pour orphelins» qu’elle affirmait autrefois construire en Haïti avec son organisme d’alors, New Reality International, et qu’elle a récemment déclaré «non-nécessaire», «car tous les enfants qui y habitaient ont grandi».
(Vous pouvez quand même continuer de faire des dons à New Reality International.)
Peut-être aurait-il fallu la questionner sur les allégations, à son égard, de publication de matériel non-consentant, matériel qu’elle aurait partagé sur son compte Twitter, prétendument pour «sensibiliser la population»? Peut-être aurait-il été utile de lui demander pourquoi elle a trouvé complètement légitime de lancer le mot en N devant le Parlement canadien? D’y citer un neuroscientifique qui croit que la fin du monde est proche - non pas en raison du réchauffement climatique, mais bien de l’industrie pour adultes?
L’article du New Yorker, qui aura failli à poser de telles questions, aura précédé de peu la série de mises à pied de MindGeek ainsi que la démission du PDG, Feras Antoon, et du chef des opérations, David Tassillo, le 21 juin.
*
Dans Things Fell Apart, le dernier podcast de Jon Ronson, il y a cet instant où le journaliste britannique remarque: «Personne ne veut être qualifié de naysayer. De sceptique. C’est pourquoi il est si rare que, dans le feu d’une frénésie, quelqu’un dise: “Attendez une minute.”»
Intitulé Believe the Children, l’épisode est dédié à la panique satanique ayant secoué les États-Unis dans les années 1980. Jon Ronson y rencontre Kelly Michaels, une éducatrice pour enfants, emprisonnée à l’époque en raison des rumeurs les plus saugrenues. Notamment, qu’elle aurait joué Jingle Bells toute nue au piano devant des bambins.
Au micro de Ronson, dans une rare entrevue, elle s’étonne que même le New York Times n’ait pas relevé alors l’improbabilité et l’absurdité de ce qui lui était reproché. Ce à quoi Ronson répond, à la blague, au nom des journalistes: «Nous n’avons jamais croisé une panique morale qui ne nous a pas titillés.»
*
Le 12 juillet dernier, le podcast Canadaland présentait son épisode intitulé The War on Porn avec l’accroche grinçante suivante:
«Le New York Times a accusé le Canada d’avoir laissé Pornhub faire de l’argent avec des vidéos de viol et de pornographie juvénile. Mais la source du New York Times s’est avérée être une croisade évangélique extrémiste et anti-sexe. Cela devrait-il avoir de l’importance? Should that matter?»
L’article en question: celui de Nicholas Kristof, intitulé The Children of Pornhub. Dans lequel le chroniqueur qualifiait MindGeek, l’entreprise qui détient Pornhub, de scène de crime. L’une des sources en question: Laila Mickelwait, alors responsable de l’abolition chez Exodus Cry.
Sandra Wesley était l’invitée principale de cet épisode de Canadaland. Selon elle, il ne subsiste toujours aucun doute: Évidemment que it should matter.
«Je sais que les gens veulent être optimistes. Et croire que, même si les sources n’ont pas des intentions claires, ça peut servir de tremplin pour aborder des problèmes importants, remarque la directrice générale de l'organisme Stella. Mais pas lorsque des gens qui détestent les travailleuses du sexe tentent de pousser de telles histoires. Rien de bon ne peut sortir de la haine.»
*
Trois jours après la parution du New Yorker, le Daily Beast a publié un article, classé dans la catégorie «Sloppy journalism». Journalisme bâclé. Le titre? How Anti-Porn Evangelicals Hoodwinked the New Yorker.
L’actrice pour adultes Cherie DeVille y relève l’erreur éthique d’avoir donné la parole à une militante aussi controversée sans offrir de contrepoids:
«Le problème, c’est que malgré les protestations de Laila Mickelwait, son but n’est pas de sauver des victimes. C’est d’abolir l’industrie de la pornographie.»
De la même façon, quelques jours après que l’éditorial de Nicholas Kristof eut explosé en décembre 2020, l’essayiste et journaliste Melissa Gira Grant publiait dans les pages du New Republic un rappel des manquements éthiques accumulés par Kristof dans ses reportages du même type, et les trous dans son histoire sur Pornhub.
Elle nous racontait alors combien de lecteurs lui avaient dit précisément ça: que peu importe d’où venaient les critiques, Pornhub était une compagnie horrible et qu’elle méritait de payer pour ses mauvaises pratiques.
Soit. Sauf que la question de qui mène la charge, de qui tire parti de la controverse, et de qui profite de celle-ci pour faire avancer son idéologie est capitale.
Surtout que «les gens qui poussent une idéologie» peut aussi être utilisé comme excuse pour ne pas régler des problèmes flagrants. Pour balayer des horreurs sous le tapis.
Kat* a travaillé pour MindGeek. Et elle l’a entendu. «Quand on recevait des critiques de l’externe, ma boss disait: “Ne t'en fais pas avec ça, ça va arriver. Il faut tout le temps qu’on deale avec ces choses-là.” Les récriminations n’étaient jamais abordées de front ou réellement prises en considération.»
Quand l’article du New York Times est sorti, Kat avait déjà quitté MindGeek. Beaucoup de choses lui avaient déplu dans la compagnie. Le papier de Nicholas Kristof lui a déplu aussi.
«Je trouvais qu’il n’était pas allé au fond des choses, qu’il y avait beaucoup d’allégations, d’opinions, de sources bizarres, de raccourcis, d’informations non vérifiées. Mais c’est dur de dire ça sans avoir l’air de dire que MindGeek, c’est des gentils. C’est pas des gentils. Ces accusations contre Pornhub n’étaient vraiment pas nouvelles. À l’interne, c’était traité comme: “Il y a toujours des gens qui associent la porn au trafic et qui ne seront pas contents”. D’accord, mais il y avait aussi des personnes qui réclamaient que leur image soit retirée, en vain. Tout était mis dans le même panier.»
Ce qui n’aidait pas, c’est que plutôt que de venir des personnes de l’industrie, qui à l’instar de l’actrice Ariel Rebel étaient immensément nombreuses à décrier les méthodes de Pornhub depuis des années, les critiques dans les médias venaient, selon Kat, de sources «vraiment problématiques: des incels contre la porn, de l’alt-right. Pour la compagnie, c’était vraiment une occasion de se dédouaner. De ne pas se soucier du fait que des gens se sentaient lésés. Parce que c’était vraiment ça, la cassette qu’on nous répétait sans cesse: “Ignorez les reproches. Ne vous en faites pas. Regardez qui se plaint!” Je suis surprise que ça ait pris tellement de temps avant que ça éclate. C’était tellement une bombe à retardement.»
*
L’article du New York Times, que même le député du NPD Charlie Angus a fini par qualifier, après quelques rencontres parlementaires, de «légèrement sensationnaliste», aura mené au déclenchement des audiences sur Pornhub, le 11 décembre 2020, par le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes.
Quarante personnes ont témoigné lors de sept réunions publiques. Parmi les choses - «étonnantes» n’est peut-être pas le bon mot -, mais déroutantes, qui sont ressorties de ces sept sessions, notons la méconnaissance criante des enjeux liés à l’internet - que les députés souhaitaient néanmoins réguler.
Par exemple, dans un moment stupéfiant, l’analyste américain en matière de sécurité Charles DeBarber est venu expliquer les différences entre le web de surface, le web profond et le dark web (on n’ose pas dire: la base).
Sa présentation souhaitait notamment démontrer que de fermer des sites référencés sur Google, comme Pornhub, pouvait pousser vers des endroits moins détectables, plus sinueux. La députée du Bloc québécois Marie-Hélène Gaudreau s’est alors dite inquiète que sur le dark web, on puisse «utiliser un faux nom».
…
On a entendu toutes sortes de choses au Parlement canadien - et ailleurs d’ailleurs.
On a entendu Pierre-Yves McSween déclarer au 98,5 qu’il fallait «organiser l’industrie de la pornographie de la même façon que l’on organise les pétrolières», puis clamer que le client de MindGeek devrait être protégé parce qu’il n’a «pas de moyen de savoir si la personne russe à l’autre bout du monde» a «16 , 18 ou 24 ans».
La personne russe à l’autre bout du monde.
En comité parlementaire, on a entendu la députée libérale de Châteauguay—Lacolle Brenda Shanahan interrompre le témoignage de trois femmes, dont Sandra Wesley, venues présenter leur connaissance et expérience de l’industrie, en déposant une motion visant à entendre «des témoins plus objectifs». La remarque a poussé Charlie Angus à crier: «This is crazy!» Ce à quoi Jennifer Clamen, coordonnatrice nationale de l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, a répliqué calmement que de voir d’autres personnes parler à leur place n’était pas «crazy!» mais plutôt tristement courant pour les travailleuses du sexe.
«Ils ont coupé notre témoignage, ils en ont fait une raillerie, se souvient Sandra Wesley. C’était irrespectueux, mais aussi familier: nous sommes rarement prises au sérieux en tant qu’expertes de nos propres expériences. D’autres, qui sont contre nous, s’expriment en notre nom, ont accès aux plateformes.»
Parmi ces personnes: Laila Mickelwait, encore. Malgré les critiques, l’activiste américaine a témoigné deux fois devant le Parlement canadien l’an dernier. Une fois pendant les audiences sur Pornhub. Une autre pour appuyer le projet de loi S-203 limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite, marrainé par la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne.
Les audiences terminées, et le projet de loi S-203 mort au feuilleton avec la fin de la 43e législature, on pensait que le nom et les idéologies de la militante seraient sensiblement oubliées.
Erreur.
Pas plus tard qu’en décembre, le point de vue de Mickelwait a encore résonné lorsqu’il a été cité par la sénatrice conservatrice Yonah Martin en introduction au dépôt du projet de loi S-210 de Julie Miville-Dechêne (version remaniée de son projet de loi S-203).
Ce projet, décrié avec véhémence en comité par le professeur de droit Michael Geist, souhaite forcer les sites web à instaurer un processus de vérification de l’âge pour interdire l’accès au contenu pornographique à des mineurs. Le projet prévoit également que les sites «contrevenants» se verraient imposer une amende. Et une ordonnance de blocage.
C’est d’ailleurs en reprenant l’une des répliques préférées de Laila Mickelwait que Julie Miville-Dechêne a présenté en janvier son projet de loi au micro de Patrick Lagacé - et le 9 février devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles: «Les enfants ne peuvent pas aller dans un sex shop ou dans un club de danseuses. Pourquoi pourraient-ils visiter un site porno?»
La formule est «efficace». Mais aussi tortueuse.
Un bar n’est pas l’internet. Présenter sa pièce d’identité à un portier n’équivaut pas à laisser sa trace en ligne. Entrer dans une boutique n’équivaut pas à entrer ses données personnelles dans un ordinateur.
Quant à cette idée que «les clics d’enfants rapportent des sous à Pornhub»... Comme nous le disait Valerie Webber, qui détient un doctorat en santé communautaire et qui siège également sur le conseil du PASS, une organisation dédiée à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’industrie pour adultes:
«Les pornographes ne veulent absolument pas d’enfants sur leur site. Même si on prend le point de vue très cynique, très capitaliste, ce n’est pas bon pour les affaires!»
Mais l’idée de sauver des enfants arrive de tous les fronts, dans les dernières années, remarque Sandra Wesley. «Il y a les tenants de QAnon qui sont obsédés par le trafic humain. Il y a toute l’histoire de Jeffrey Epstein, qui a poussé bien des gens à conclure que toutes les conspirations sont réelles. Puis, il y a le mouvement prohibitionniste. Et les tactiques mises en place pour pousser les gens à s’impliquer dans ces histoires. Par exemple, à Montréal, l’Opération Radar qui forme les employés d’hôtel ou de taxi à repérer des travailleuses du sexe et à en rendre compte à la police. Parce qu’on leur dit “vous pourriez les sauver”. Tout le monde devient, en quelque sorte, un justicier.»
*
On revient donc à cette question: Does it matter? Cela devrait-il avoir de l’importance?
Tout a de l’importance dans des sujets aussi cruciaux.
Prenez par exemple I Am Jane Doe.
Narré par Jessica Chastain, ce film paru en 2017 retraçait la saga juridique et politique entourant Backpage, un site de petites annonces qu’utilisaient autrefois de nombreuses travailleuses du sexe. Accusée de faciliter le trafic d'enfants, la plateforme sera fermée par les autorités et inspirera le passage des lois FOSTA-SESTA, signées par Donald Trump en avril 2018.
«FOSTA-SESTA sont construites comme des lois anti-trafic humain, mais sont, en réalité, des lois anti-travail du sexe. Depuis leur passage, tous les sites peuvent être criminellement responsables s’il y a du travail du sexe sur leur plateforme, rappelle Sandra Wesley. Ça mène à la censure sur Instagram ou sur Twitter. Au retrait de contenu sexuel sur Tumblr. À des choses absurdes comme le bannissement de l’emoji d’aubergine sur Facebook.»
Car les cas d’abus et de violence sont tragiques - mais ces lois qui en découlent n’aident pas forcément à les régler.
C’est le Government Accountability Office qui l'a révélé en juin dernier: le passage de FOSTA-SESTA a rendu la traque de criminels autrement plus compliquée. Et c’est le New Republic qui l’a rappelé: au final, la nouvelle loi n’a été appliquée qu’une seule fois. Parce que des lois en ce sens existaient déjà.
La fermeture de Backpage, pourtant, a eu des répercussions réelles sur les personnes travaillant dans l’industrie, les poussant vers des sites plus obscurs. Elle a également rendu le traçage de contrevenants nettement plus labyrinthique.
FOSTA-SESTA représente d’ailleurs ce que Sandra Wesley appelle: «La première brèche dans la section 230.»
Pour rappel, dit-elle, la section 230 du Decency Communications Act aux États-Unis, «est celle qui nous a menés à avoir l’internet que nous avons aujourd’hui. C’est cette loi qui affirme que les sites ne sont pas responsables du contenu publié par les utilisateurs. Qui fait en sorte que les médias sociaux et les services de courriels peuvent exister. Que le contenu généré par les utilisateurs représente une grande partie de ce que l’on trouve en ligne.»
Une loi pour laquelle, aparté, le «Loup de Wall Street» Jordan Belfort, celui-là même qui a inspiré le biopic de Scorsese, a été «crédité».
*
Pour revenir à I Am Jane Doe, s’agit-il d’un simple documentaire? En se rendant sur le site officiel du film, on tombe sur une «liste de ressources» parmi lesquelles se glisse Demand Abolition, un organisme accusé d’avoir mené des opérations d’infiltration violentes et inconséquentes. Polaris Project, qui a déjà affirmé que les téléphonistes érotiques étaient des «esclaves modernes». Et la fondation Thorn, d’Ashton Kutcher, accusée de tirer profit du filon de l'exploitation et des fausses statistiques pour pousser une technologie dangereuse et potentiellement utilisable à des fins totalitaires.
Encore une fois: est-ce vraiment, à 100%, de protection des enfants dont il est question ici? Ou aussi, beaucoup, d’idéologie? «C’est pour cette raison que de plus en plus de groupes font du trafic et de l’exploitation sexuelle leur sujet principal, remarque Sandra Wesley. Parce que ça convainc les gens d’adopter des mesures répressives avec lesquelles ils n’auraient jamais été d’accord autrement. Le public ne va pas se faire avoir par “Facebook devrait être fermé s’il héberge du contenu gai”. Mais: “Facebook devrait être fermé parce qu’il tolère le trafic humain”, ça sonne mieux. Donc ils commencent avec Pornhub. Et si le plan fonctionne, ça va s’étendre à d’autres sites.»
«C’est ça qui est particulier, remarque Kat. Dans le discours public, on n’a pas parlé du fait que ces militants contre Pornhub instrumentalisent le mouvement pour promouvoir leur propre agenda. Il y a des journalistes qui n’ont pas fait leur job. Et des gens, notamment du côté du Parlement, qui ont oublié de vérifier qui étaient ces groupes soit religieux, soit super racistes, soit super conservateurs. Je pense qu’il y a des fautes de chaque côté.»
*
La question est d’autant plus décisive que le slogan semble s’insinuer dans tous les coins. Dernièrement, des influenceurs ont promu agressivement une nouvelle cryptomonnaie nommée «Save the Kids Token» - mais plutôt que de sauver les enfants, ou du moins, de leur donner un coup de main, ils en ont profité pour faire du dumping.
Le nouvellement redéposé et controversé Earn It Act joue dans les mêmes eaux.
Earn It. Le mériter.
Comme dans «mériter sa section 230 du Communications Decency Act».
Présenté pour la première fois au Congrès américain en mars 2020, le projet, qui vise notamment à rendre les sites responsables pour tout le contenu publié par les usagers, s’était attiré une montagne de critiques de défenseurs du cryptage et d’associations pour les droits de la personne.
Le Earn it Act a notamment été qualifié par les animateurs de Destination Linux, un podcast dédié à l’informatique en libre accès, de «projet absolument dégueulasse, qui instrumentalise la cause des enfants pour causer la ruine du cryptage».
«Ce n’est pas la première fois que le gouvernement tente de se saisir de notre vie privée et de nos données, sous le prétexte de “sauver les enfants, d’arrêter les terroristes”, a rappelé l’un des animateurs, Ryan. Il nous enfonce cette idée dans la gorge, comme si les criminels n’allaient pas, simplement, utiliser d’autres logiciels - ou, genre, payer 10 dollars pour avoir accès à un VPN.»
«J’ai trois enfants. Je déchiquèterais en morceaux quiconque essaierait de leur faire du mal, a renchéri son collègue Michael. Mais cette loi est conne. Si quelqu’un veut me dire exactement comment elle va aider à capturer les exploiteurs d’enfants, je serais ravi d’en débattre. Tout ce qu’ils essaient de faire, c’est de gruger la vie privée dans l’espoir que des imbéciles se fassent pincer dans le processus.»
Conclusion: «La seule chose étonnante, c’est qu’ils n’aient pas nommé ça le Don’t Kick Babies Act.»
*
Car les noms et les filons dramatiques sont fréquemment détournés pour tirer sur la corde sensible du public. «Les activistes qui veulent nous éradiquer et qui s’expriment dans les médias ont toujours des histoires sensationnalistes pour les journalistes, estime Sandra Wesley. Mais ce ne sont pas leurs histoires. Ce n’est pas leur violence. C’est ironique, puisqu’ils disent être “la voix de ceux qui n’en ont pas”, à quel point ils font des efforts pour que nous ne soyons pas entendues. Ce n’est pas que les histoires d’horreur n’existent pas dans l’industrie. Mais nous croyons que nous devrions avoir accès aux droits humains sans avoir besoin de faire pleurer personne.»
Le Earn it Act possède son lot de supporters. Parmi ceux qui l’appuient avec férocité, notons Operation Underground Railroad, une organisation composée d’ex-Navy Seals qui jouent aux gros bras en Haïti, faisant notamment des descentes armées dans les maisons closes, ordonnant aux travailleuses du sexe de se mettre à terre. Et puis NCOSE. Ou le National Center on Sexual Exploitation. Un des organismes qui mènent aussi la charge contre Pornhub.
«National Center on Sexual Exploitation. Le nom sonne presque… banal, remarque Sandra Wesley. Mais c’est le même groupe qui se nommait autrefois Morality in Media. Et qui a été fondé dans les années 1960 par des hommes très outrés que le magasin du coin vende des recueils de nouvelles érotiques. Ils ont fait les manchettes dans les années 1980 et 1990 en boycottant Madonna. Et Disney. Vous vous souvenez du monologue de George Carlin? Seven Words? C’est un membre de Morality in Media qui s’était plaint.»
Pour rappel: par un après-midi de 1973, l’auditeur, choqué par les blagues teintées de «shit», de «fuck» et de «tits» du légendaire humoriste, porte plainte contre le diffuseur, Pacifica.
L’affaire se rend jusqu’en Cour suprême des États-Unis. La question au coeur du litige: «Quelle est la différence entre l’indécence et l'obscénité? Et est-ce que la FCC (l’équivalent du CRTC aux États-Unis) a le pouvoir de censurer l’une ou l’autre?» Carlin n’est même pas invité à témoigner. C’est Pacifica qui l’est, à titre d’éditeur.
Dans une décision rendue en 1978, la cour donne à la FCC le droit d’interdire les sept mauvais mots de Carlin à la radio et à la télévision.
*
Ce printemps, l’Université de Calgary présentait un sommet sur les dangers de la pornographie, promu par Julie Miville-Dechêne. Parmi les panélistes se trouvait le Dr Donald Hilton. Celui dont on vous parlait plus haut, ainsi qu’ici, et qui affirme que la pornographie va vous arracher femme, mari, frère, soeur et enfants.
Le congrès n’avait pourtant pas pour titre «les pornographes sont plus dangereux pour les femmes que les talibans» (une phrase déjà prononcée par Hilton), mais un plus subtil «Stronger Together: Protecting Children from Online Pornography by Inviting a Public Health Response».
C’est aussi l’idée de «protéger la santé publique» que le projet de loi S-210 met de l’avant.
Une chose contre laquelle Lara Karaian, professeure associée à l’Institut de criminologie et de justice pénale de l’Université Carleton, s’est insurgée devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles.
«Parler de pornographie comme d’une crise de santé publique mène à des politiques inconstitutionnelles, à pathologiser des comportements sexuels, à restreindre la liberté sexuelle et à créer des préjugés sur les comportements sexuels, que ces derniers soient normatifs ou pas.»
Lara Karaian a également souligné que plutôt que de censurer, «on devrait mieux comprendre la valeur de la pornographie». Puis, elle a rappelé que certes, la porno peut avoir certains effets négatifs - mais aussi Photoshop. Et que des images qui ne sont pas de notre goût ne sont pas forcément non-consensuelles. «On aimerait peut-être mieux ne pas les voir, mais ça ne signifie pas qu’elles sont criminelles.»
Reste que le contrôle des images est l’une des choses principales sur lesquelles devrait se concentrer Pornhub, estime Kat. De son passage à MindGeek, elle se souvient: «Je n’ai pas l’impression que la vérification du contenu était vraiment prise au sérieux. Et quand il y avait de petites manifs devant les bureaux, ils n’étaient jamais inquiets. Je pense qu’ils se croyaient vraiment au-dessus des lois. D’ailleurs, quand l’article du New York Times est sorti, j’ai contacté mes anciens coworkers pour dire: “Ça ne va pas bien aller.” Je ne m’attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, mais tout d’un coup, plus personne n’avait envie de travailler là. Pourtant, ils aimaient leurs collègues, leurs conditions de travail. Je pense que leur départ en dit long sur ce qu’ils pensaient de la situation. Reste que la devise de la compagnie est restée: nous, on ne se prononce jamais. C’est la même manière dont ils se sont défendus pendant les audiences: on ne dit rien, on n’entend rien.»
Le désormais ex-PDG de MindGeek, Feras Antoon, a fini par parler dans un reportage de Vanity Fair paru en janvier, et intitulé: «XXX-Files: Who Torched the Pornhub Palace?».
Et même à cette question, visant à trouver qui a bien pu incendier en avril 2021 le manoir montréalais du «roi de la porno», plusieurs lecteurs ont répondu par un haussement d’épaules, rappelant que la source n’a pas d’importance si la finalité est celle qu’ils désirent.
«Who done it? Who cares who done it?» a-t-on pu lire. «God did.»
*
Le 3 janvier dernier, l’animateur de Canadaland, Jesse Brown, revenait sur le scandale de Pornhub. Celui qui, quelques mois plus tôt, clamait: «Je comprends le point de vue de Charlie Angus et de ceux qui disent: je m’en fous où cette campagne contre Pornhub a commencé. Je me fous de savoir si ses organisateurs sont anti-pornographie ou anti-travail du sexe. Je ne le suis pas. Je veux seulement aider des jeunes femmes à enlever leurs vidéos de Pornhub» en venait, finalement, à un semblant de révélation. Il n’y a pas que des vilains moustachus anonymes et des gentils. Il y a aussi des personnes qui subissent des dommages collatéraux. «La finalité narrative n’existe pas. Les histoires se terminent rarement juste parce que nous avons fini de les raconter.»
*Prénom fictif, pour protéger l’anonymat
Ce texte fait partie de Nouvelles intimes, un espace de liberté et d'exploration de sujets plus tabous en société. Pour ne manquer aucune édition de cette infolettre signée Mélodie Nelson et Natalia Wysocka, et pour lire nos parutions précédentes, suivez-nous sur Instagram au @nouvellesintimes et abonnez-vous au nouvellesintimes.substack.com.
Des commentaires, des questions, une histoire à nous partager? Écrivez-nous au nouvellesintimes@gmail.com.