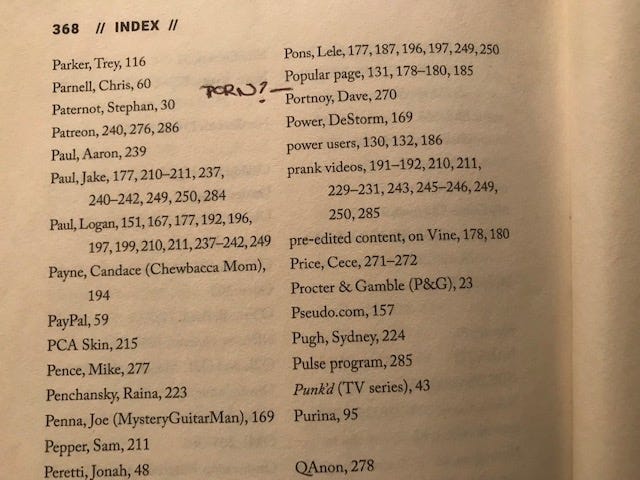Internet s’est bâti sur la pornographie
Taylor Lorenz raconte l’histoire du web en omettant sa plus importante partie.
Texte par: Natalia Wysocka
C’est le titre d’un article de Vox qui m’a intriguée. Ouhhhh. «Comment la bataille entre les fondateurs de la tech et les influenceurs a modelé l’internet».
Tout aussi intrigant était le sous-titre: «Dans le nouveau livre de Taylor Lorenz, les femmes extrêmement en ligne obtiennent leur dû.»
Taylor Lorenz écrit sur la technologie. Elle dit parler au nom des personnes marginalisées. Elle clame n’avoir jamais eu la liberté souhaitée dans les médias traditionnels qui l’ont employée pour raconter toutes les histoires du web qu’elle aurait aimé. Sûrement qu’elle le ferait ici. Sans doute y ferait-on mention de Lenna Sjööblom. Qu’on pourrait lire sur Marie Calloway. Peut-être sur Jennicam? Le mouvement body positive? La fin de Stripper Web? Sur l’emoji d’aubergine censuré, certainement. Clairement sur Backpage. Éventuellement sur Cat Marnell? Assurément sur l’impact et les barèmes de la section 230. Sur les comptes aléatoirement supprimés pour cause de nudité. Sur le scandale Pornhub. Sur les batailles politiques. Sur les combats moraux.
Silence.
L’entrevue de Vox fait 2936 mots. Je l’ai relue deux fois parce qu’il me semblait clair que j’avais manqué quelque chose. Sûrement que dans les 2936 mots sur l’histoire du médium qui a quand même été la première porte d’entrée vers des images pixelisées de nudité, il y aurait une reconnaissance de cette réalité.
Comme une encyclopédie sur le pain dont serait absent le mot «levure», l’article semblait faire tout en son possible pour ne pas mentionner, jamais, chhhhuuuuut, le terme «porn».
Néanmoins. Une histoire NEVER TOLD BEFORE de l’internet. J’ai acheté le livre, intitulé Extremely Online.
Puis je l’ai lu. Juste une fois celui-là. Je ne pense pas qu’il aurait été possible de supporter une seconde relecture de cette série de faits débités de manière robotique où des types comme Logan Paul sont mentionnés comme exemples absolus de réussite, sans critique, parce que hey, qui n’a pas ambitionné de connaître la gloire en insultant la dépouille d’un homme suicidé, n’est-ce pas.
(À la décharge de la journaliste, elle finit par mentionner la controverse. À la page 237. Pour nous dire que lorsque la chaîne YouTube de Logan a été démonétisée en raison du scandale, il a continué de faire beaucoup de sous avec ses hoodies. Que voulez-vous, il est clairement un magicien du marketing.)
Sinon, l’essai énumère des «moments marquants» de la chronologie d’internet, du chat grincheux à la madame avec un masque de Chewbacca, en échappant le thème principal.
Comment un récit sur, soi-disant, les influenceurs les plus marquants de l’histoire de l’internet peut-il mentionner deux fois les pinottes Wonderful Pistachios, mais zéro fois Natalie Wynn?
Certes, cet ouvrage aurait pu être juste un autre livre à la couverture relativement moche et au propos liquéfiant. Sauf qu’il clame raconter la vérité. Sauf qu’il est encensé de partout. Sauf que, surtout, il s’appuie sur une thèse qui apparaît soit complètement mal informée, soit complètement déconnectée, soit complètement cynique. «Content creators today are more powerful than ever!»
Huh?
Il suffit de quelque chose comme six secondes de réflexion et une pensée pour la 24e lettre de l’alphabet (X) pour savoir que c’est faux.
Tumblr s’est sensiblement écroulé? C’est à cause de son refus de se moderniser! peut-on lire. Sur Instagram, il y avait de nouvelles fonctions cool, mais Tumblr n’était plus cool.
Est-ce… sérieux? Cette théorie a vraiment été publiée?
Quiconque connaît, même de loin, le cours des événements, sait pertinemment qui si la plateforme s’est plantée, c’est parce qu’elle a soudain banni le contenu pour adultes en 2018.
Plus précisément: toute représentation «of female-presenting nipples».
C’est par ces mots que le pdg a présenté sa décision à l’époque. Ce n’est pas parce que des gens assoiffés de latte art ont décidé que Tumblr était dépassé. C’est parce que les hauts dirigeants ont restreint la liberté d’expression.
«Fondamentalement, je veux changer la façon dont les gens voient internet. Je veux qu’ils le voient de la façon dont je le décris», a déclaré Taylor Lorenz au podcast d’Emily Ratajkowski.
Mais si on efface le travail du sexe de cette histoire, comment le défendre ensuite contre ceux qui veulent le bannir entièrement? Comme ces groupes qui veulent éradiquer la porn, fini, on fait comme si elle n’avait pas existé. Voilà donc un internet sans images érotiques tout à fait acceptable pour eux - et plausible.
Et puis, si on veut combattre la misogynie, comment encenser des personnes qui l’ont propagée dès les tout débuts?
Exemple: Ashton Kutcher est mentionné quelque chose comme sept fois dans le livre. Toujours comme personnage gentil-gentil-sympa-sympa. Néanmoins, Ashton Kutcher, c’est avant tout le gars qui a créé Thorn, un organisme qui prétend lutter contre le trafic humain, mais qui a surtout été démonté pour ses liens avec les forces de l’ordre répressives ainsi que sa vision floue du respect de la vie privée (et, surtout, son incapacité à sauver qui que ce soit).
C’est également le gars qui a écrit une lettre larmoyante pour défendre Danny Masterson, son ami accusé d’agressions.
L’histoire «untold», celle qu’on aurait dû raconter, c’est avant tout celle-là: l’histoire de l’hypocrisie ambiante, des corporations qui prétendent agir au nom du bien commun, des stars qui utilisent l’excuse éternelle «sauver les enfants» pour s’en mettre plein les poches (et, divulgâcheur, ne pas aider d’enfant).
Ironiquement, en souhaitant défendre aussi platement la création de contenu (et, pour une raison insensée, le drop-shipping?!), le livre avance l’idée, de plus en plus répandue, que de créer du contenu est facile. Que d’analyser un film est facile. Que d’élaborer des vidéos de fitness est facile - voire futile.
Ce même stéréotype qui a eu cours pendant la pandémie, voulant que OnlyFans soit à la portée de tous, magie. Une photo en bikini et vous voilà millionnaire!
(Et pendant ce temps, les victimes collatérales de ce mythe se multiplient: les infirmières qui reçoivent des avertissements ou se font démettre de leurs fonctions. Les enseignantes et assistantes qui perdent leur emploi.)
Ne pas reconnaître l’ampleur de ce travail entraîne les dérives, le mépris, l’incompréhension.
Ainsi, dans un récent épisode d’Au-delà du sexe, l’animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin visite le donjon de la dominatrice Goddess Ges qui lui offre une incursion dans son univers professionnel.
Assise sur un fauteuil, l’animatrice regarde Goddess Ges à l’oeuvre, en se détournant sans cesse pour faire des grimaces de douleur théâtrales. Malgré tout, l’animatrice veut savoir: comment peut-elle, elle-même, «développer son autorité»?
Le soumis encagoulé de Goddess Ges s’étouffe de rire. D’une voix posée, cette dernière répond simplement: «Tu ne deviens pas dominatrice du jour au lendemain. Surtout pas professionnellement.»
C’est un travail. Ça prend du travail. Énormément de travail.
*
Marketé comme un livre souhaitant redonner aux influenceuses la place qui leur revient, Extremely Online les éradique pourtant quasi complètement au profit d’un déluge-magma de Chase, Chad, Jaden, Dustin, Shaun, Josh et autres Dick.
Étrangement, dans le plus prometteur des chapitres, celui sur les Mommy Bloggers, la journaliste relate le destin funeste de Heather Armstrong, qui a subi les foudres du public pour avoir raconté son quotidien de maman sur son site, dooce.com.
Celle qui a cessé de publier il y a quelques années, étourdie par tant de haine, a fini par s’enlever la vie après une rechute alcoolique. Comment Taylor Lorenz peut-elle clamer, alors, que le pouvoir est aux créatrices de contenu? (Dernièrement, il semble surtout l’être aux néo-nazis.)
Dans un passage similaire, on peut lire que la musicienne Baby Ariel s’est «éloignée de la vie en ligne, car, même au sommet, elle ne se sentait pas en sécurité».
Plus loin, le meurtre de la Youtubeuse Christina Grimmie est noté juste en passant, pour conclure que, suite à ce drame, «l’accès au lounge dans des événements comme VidCon a été restreint».
Pas que la misogynie en ligne se traduit dans la vraie vie, pas que les choses devraient changer. Seulement que plusieurs visages célèbres de la défunte application Vine, certains par ailleurs accusés de comportement inapproprié, n’ont pas eu la chance de faire autant de meet and greet.
Encore ici: la blogueuse de mode Arielle Charnas est dépeinte comme «un succès!!!», alors qu’une enquête de Business Insider a depuis démontré qu’avec son ancienne marque de vêtements, Something Navy, elle a «omis» de payer collaborateurs et fournisseurs, que certains l’ont qualifiée de «Bernie Madoff du style» et que son mari est présentement sous enquête pour délit d'initié. Mais saviez-vous qu’elle a déjà fait des pubs de cheveux avec TRESemme?
Incompréhension aussi à la lecture de cette section interminable sur tous les contrats publicitaires conclus entre tel teen-idol de Vine et telle compagnie pour telle gargantuesque somme d’argent. Soudain, une mention: «la plupart de leur contenu était raciste, sexiste, misogyne, homophobe». Mais hey, ils ont fait de bons deals publicitaires, alors à quoi bon creuser ce filon?
Pourquoi rappeler que tel créateur a tenu des propos inacceptables, si on peut rappeler qu’il se souvient avec nostalgie des tournées où il était au sommet de sa popularité et se désoler des défis qu’il a dû surmonter face aux contraintes de la plateforme? (Pour vrai, c’est une vraie phrase: «The tour era is still remembered fondly by Vine stars like Cameron Dallas and Nash Grier and their fans. (...) The creator class was doing what it had done each time it had been faced with constraints: develop new revenue pathways.»)
Mais «développer de nouvelles sources de revenus» n’est pas l’apanage de ceux qui ont lancé des t-shirts avec leur face dessus.
«Encore et encore, par nécessité, les travailleuses du sexe ont été les premières à adopter les technologies et à innover, mais aussi à se confronter aux nouvelles formes de surveillance, de censure, de criminalisation, et d’atteinte à la vie privée», lance l’animatrice Livia Foldes, en introduction à Sex Workers Built the Internet.
Présentée l’an dernier par le collectif Decoding Stigma ainsi que Hackling/Hustling, qui se bat «contre la violence facilitée par la technologie», cette table ronde explore le passé, les potentiels et les périls du web, les avantages de voir les innovations «utilisées et réinterprétées par celles qu’elles ont le plus blessées» ainsi que, comme le titre l’indique, comment les travailleuses du sexe ont modelé la vie numérique.
Parmi les sujets abordés: une annonce personnalisée de la première heure qui ne parlait pas seulement des services offerts, mais aussi de cette invention inouïe qu’était le modem.
«Ces femmes incitaient les gens à se renseigner sur la technologie. Si bien que, quelqu’un qui n’avait pas de modem, était soudain en train de se demander mais comment je fais, moi, pour accéder à cet espace féerique?!» y remarque Gabriella Garcia.
La cofondatrice de Decoding Stigma remercie également les blogues d’autrefois, alias «cette deuxième vague de gentrification du travail du sexe sur la toile», qui ont malgré tout et selon elle, «démystifié et humanisé le sex work, offrant un sentiment de communauté et de sécurité».
Un regret, cependant: «La vitesse avec laquelle nous oublions qu’il n’y a pas si longtemps encore, le sexe était la raison principale pour laquelle les gens se connectaient à internet.»
Autre chose que l’on oublie: «l’importance de l’interactivité lorsqu’il est question d’industrie pour adultes et de technologie», se désole Tina Horn, auteure de la bédé SFSX et animatrice du merveilleux podcast Why Are People Into That?!. On ne peut pas sous-estimer à quel point, à l’époque révolue des bulletins électroniques, la simple idée que quelqu’un pourrait émerger de ce néant mystérieux pour discuter avec nous était absolument époustouflante.»
Sinnamon Love, réalisatrice de films pour adultes qui travaille depuis 29 ans dans l’industrie, renchérit: «Même les fonds d’écran des sites web se sont adaptés, de très épurés à très foncés, pour éviter de refléter la lumière si le mari écoutait de la porn la nuit.» Et aujourd’hui? «Les influenceurs louent un studio pour produire du contenu. Mais les travailleuses du sexe utilisent des chambres d’hôtel pour tourner du contenu depuis la nuit des temps et de l’éros. On réserve une chambre pour travailler? Aussi bien en profiter pour faire une séance photo et un cam show. Les sex workers sont les créatrices de contenu originales!»
(Certains attribuent même la naissance des «reactions videos» sur YouTube, aujourd’hui inéluctables, à la viralité de Two Girls, One Cup.)
«Les travailleuses du sexe ont rendu l’internet désirable, accessible, profitable.» Malheureusement, déplorent toutes les panélistes, elles sont souvent effacées de l’histoire populaire, ignorées.
Comme pour prouver leur point, Extremely Online ignore ostensiblement ces avenues (mais fait des Sway Boys des personnages historiques déterminants). Seule exception: comme une note de bas de page ajoutée à la dernière minute, OnlyFans occupe précisément une page + 1⁄2 paragraphe du livre, à la toute fin.
On y apprend que la plateforme «fait partie d’une transformation plus grande, commencée en 2020, de créateurs faisant de l’argent directement grâce aux abonnements des fans».
(Sauf qu’on pouvait déjà s’abonner au Club des Baby-Sitters par la malle.)
On lit aussi qu’OnlyFans a «déplacé les réseaux sociaux du mur de Paul Smith - le rose, celui devant lequel tout le monde posait à L.A. en, genre, 2017 - vers la chambre à coucher. Offrant quelque chose de beaucoup plus intime.»
S’il est vrai qu’OF a offert beaucoup, il est complètement faux d’avancer que la plateforme a été la première à le faire. Suffit de penser à Danni’s Hard Drive, à Ana Voog, à Asia Carrera…
Dans les remerciements à la fin du livre, l’auteure salue néanmoins «les reportages approfondis de EJ Dickson sur le sex work et OnlyFans».
EJ, journaliste pour Rolling Stone, a effectivement publié des articles sur la question. Un exemple : «‘We Feel Like We’ve Been Scammed’: OnlyFan Models Allege Managers Exploited Them During Covid-19 Boom.»
Dommage que rien n’a été retenu de ces articles, si ce n’est qu’une mention: «Il aurait été naïf de penser que la majorité des sex workers sur OnlyFans auraient été capables de prospérer financièrement, malgré les tonnes d’argent que le site faisait.»
L’incapacité de transmettre une quelconque substance dans un sujet pourtant si riche vient peut-être du mépris, des préjugés, des idées reçues avec lesquelles est perçu le thème de la sexualité - plus particulièrement celle en ligne.
Traitée, sous sa forme consentante, comme ennemie à abattre, danger unilatéral et, plus récemment dans les cercles évangéliques américains et au Sénat du Canada, «un problème de santé publique».
Est-il possible de raconter une histoire de l’internet qui soit juste? Qui, plutôt que de déifier un type nowhere parce qu’il a participé à une pub pour un laptop quelque part en 2014, rappelle que c’est Hedy Lamarr qui a inventé le wifi?
Une histoire «untold» ne devrait-elle pas raconter des événements qui n’ont pas déjà été dépeints en long-large-travers dans Hype House, une téléréalité de Netflix qui retraçait le quotidien d’un groupe de TikTokeurs massés dans un manoir de L.A?
Là où, entre une destruction de plantes en pot, d’innombrables scènes de végétation, et quelques rares moments d’amitié et d’acceptation, même l’un des protagonistes posté dans sa chambre aux murs couverts de photos de sa propre face remarquait: «On mène cette vie et on gagne des sommes d’argent que n’importe qui âgé de 21 ans, ou que n’importe qui, en fait, ne devrait tout simplement pas gagner.»
(Autres perles de ce type tirées de Hype House:
«I’m bored, i want a Tesla.»
«I’m tired. All i do is help people. I’m just such a giver.»
Et l’ultime: «Pain is temporary. Footage is forever.»)
À une époque de rénovictions en série, de logements absurdement inabordables, de démembrements de campements de fortune, de San Francisco à Montréal, des phénomènes comme feu le Hype House auraient pu inspirer une réflexion relativement, disons, intéressante, sur la cohabitation artistique, sur la façon de survivre en tant que créateurs dans un monde de plus en plus impitoyable, sur la force du collectif.
Mot clé: aurait pu. Car si on s’entend sur l’appel final inespéré de Extremely Online à «not surrender decision-making to Silicon Valley executives», la conclusion de l’essai demeure dramatiquement élitiste et déconnectée: «L’influence en ligne peut faire de vous une sensation hollywoodienne du jour au lendemain, vous métamorphoser en dirigeant d’entreprise puissant, ou vous mener vers la Maison-Blanche. Un fait qui ne sera qu’exacerbé par la montée de l'intelligence artificielle. Les institutions qui refusent de s’adapter continueront de sombrer dans l’oubli.»
Les institutions qui refusent de s’adapter? Que fait-on des travailleurs qui n’ont pas les moyens de le faire?
«Je suis une optimiste de l’internet. Mais ces derniers temps, c’est vraiment difficile.»
Dans son livre, How Sex Changed the Internet and the Internet Changed Sex, Samantha Cole raconte comment, en tant qu’adolescente ayant fait l’école à la maison dans les années 1990, internet était «son campus». Comment, sur les messageboards, elle échangeait des potins, des poèmes, des photos avec des gens qu’elle connaissait uniquement par leur nom d’usager. Comment la police de caractère choisie sur ces babillards électroniques, Comic Sans rose, Times New Roman vert, faisait office de personnalité. Il était question de construction - de soi, d’identité, d’univers.
«Mais le sous-texte de toutes ces conversations au sujet de la religion, de la poésie, ou de la politique, c’était la romance. Nous ne nous étions jamais rencontrés.» Et pourtant. Ces premiers amours, coeurs brisés, relations signifiaient quelque chose. «Quelqu’un m’a offert un bouquet de fleurs pixelisées.»
Elle enchaîne: «Aujourd’hui dans ma trentaine, je passe des heures chaque jour scotchée à Twitter et à l’Instagram de Meta. Deux monopoles qui ont dévoré, puis régurgité, les sites Geocities et les bulletin boards qui ont autrefois été mes demeures digitales.»
Elle a vu la fragilité de ces demeures, les murs excluant plutôt qu’accueillant à mesure que les conditions d’utilisation se faisaient plus sévères, plus aléatoires, plus rigides.
«Sous la surface de tout ce consumérisme et tout ce chaos», une certitude: «Le désir d’explorer et de partager notre sexualité a construit l’internet tel que nous le connaissons aujourd’hui. Pièce par pièce. Avant que les milliardaires technocrates ne trahissent le sexuel au profit de l’aseptisé et du sécuritaire.»
Ce qui est salutaire dans l’essai de Samantha Cole, comme dans la vie, ce sont les nuances, la reconnaissance de la complexité qu’elle apporte à sa réflexion sur l’expression sexuelle virtuelle, qui a le droit d’y participer, qui décide comment on le fait, qui en profite, qui la censure. Elle démontre comment, entre identités tronquées et expérimentations extravagantes, c’est toujours le désir d’intimité qui a poussé les technologies - et pas l’envie dévorante de signer un contrat avec Billabong.
«L’internet a changé l’amour, la pornographie et nos goûts érotiques de davantage de façons que nous pouvons l’imaginer. Et vice-versa. Malgré la volonté avec laquelle les personnes en situation de pouvoir, les monopoles de Silicon Valley ou les investisseurs tentent de l’effacer. C’est une histoire de contrôle. Une histoire qui continue d’être écrite en ce moment même.»
C’est à ce «moteur humain le plus élémentaire» qu’elle attribue: «la structure intrinsèque d’internet, son architecture, ses codes, ses normes, ses transactions d’affaires. C’est ce qui a donné lieu au panier d’achat virtuel, aux témoins de navigateur, à certains modèles de revenus publicitaires, aux processeurs de paiements et à la page web dynamique.»
Dans How Sex Changed the Internet and the Internet Changed Sex, elle relate par exemple le récit de la modèle suédoise Lena Forsén qui a posé nue en tant que Miss Novembre 1972. Son portrait, imprimé en page centrale du Playboy, a été utilisé, à son insu, comme image test pour développer la numérisation de photos physiques et donner naissance aux jpeg.
Samantha Cole raconte aussi les babillards électroniques d’autrefois agissant comme endroit où transmettre en privé des infos sur le sida, pour ceux qui n’y avaient pas accès. Ou comme lieu où discuter de la possibilité de baiser en faisant de la plongée (une discussion qui s’est poursuivie d’août 1997… à janvier 2020).
Au podcast ICYMI, Rachelle Hampton a louangé le travail d’archiviste de Samantha Cole qui a permis de restaurer tant d’éléments oubliés. Tant de choses disparues, erreur 404.
(Le nouveau site que la journaliste a lancé avec ses collègues après des années à couvrir la sexualité et la technologie pour Motherboard s’appelle d’ailleurs 404.)
Ce travail est capital. Car si on oublie-aseptise le passé, et qu’on laisse le présent-l’avenir à l’IA, les choses ne peuvent que mal aller. («AI-Assisted Fake Porn is Here and We’re All Fucked», titrait d’ailleurs la journaliste en 2017.)
«Je suis descendue dans des tas de trous de lapin en écrivant ce livre», a confié Samantha Cole en entrevue avec Adult Empire. Au fil du périple, elle a déniché plein de trésors et de communautés inusitées. «C’est une chose vraiment cool que l’internet a fait pour la sexualité: permettre aux gens de découvrir qu’ils aiment quelque chose qu’ils ne savaient pas qu’ils aimaient. Comme l’inflation.»
(Précision: l’inflation comme dans «le fétiche du gonflement». D’une partie du corps et non du coût de l’essence. «Ce n’est pas, genre, du monde qui regardent le prix des oeufs grimper et qui font wow!»)
«Quand on écrit sur la sexualité, on écrit sur les personnes marginalisées. Sur celles qui, les premières, affrontent dans la tech ce que le grand public devra éventuellement affronter: la censure, la discrimination, les systèmes bancaires inéquitables, Twitter qui plie bagage et finit par exploser», a-t-elle précisé lors d’un entretien sur C-Span avec l’écrivaine Liara Roux.
Liara Roux qui a raconté sa vie d’escorte dans l’autobiographie Whore of New York. Et qui a rencontré Samantha Cole alors que cette dernière écrivait, il y a six ans, un article sur Patreon qui avait commencé à resserrer ses conditions et à refuser les paiements aux travailleuses du sexe.
Une citation de Liara, tirée de l’article paru en 2017: «Toutes les plateformes finissent éventuellement par nous expulser. Oui, nous pouvons publier sur Pornhub, qui fonctionne principalement avec le contenu qui nous a été volé. Où sont nos droits? Pourquoi cette histoire se répète-t-elle, encore et encore, peu importe la plateforme que nous utilisons?»
Toutes ces années plus tard, les choses n’ont pas tant changé, a réitéré Liara Roux sur les ondes de C-Span. «Même si c’est la sexualité qui a alimenté et propulsé l’essor d’internet, l’excitation amenée par toute cette nouveauté et toutes ces possibilités a très rapidement été récupérée par notre pire ennemi: MindGeek.»
Ce dernier a créé «un système amoché, basé sur le piratage des autres, de soi, de tout le monde». «Ils ont vraiment mis l’industrie à sec, soutient-elle. Avec leur équipe d’avocats massive, leurs achats de compagnies en série et leur façon d’agir tellement insidieuse, ils ont créé un monopole dément. C’est seulement en s’éduquant sur ces choses qu’on peut réellement commencer à les réparer.»
De renchérir Samantha Cole: «Ils ont transformé la sexualité en quelque chose qu’un algorithme peut lire et essayer de nous resservir. Nous avons beau être optimistes, tout devient merdique! Nous ne pouvons plus nous cacher la tête dans le sable.»
Reste que… «on ne peut ignorer le pouvoir de ce que les gens veulent de l’internet. Et ce que les gens veulent, c’est un désir puissant de s’exprimer - la plupart du temps, par la sexualité. Je ne sais pas comment le dire de façon plus élégante ou éloquente, mais… les gens sont horny. Et ils le seront jusqu’à la fin de l’humanité.»
Ce texte fait partie de Nouvelles intimes, un espace de liberté et d'exploration de sujets plus tabous en société. Pour ne manquer aucune édition de cette infolettre signée Mélodie Nelson et Natalia Wysocka, et pour lire nos parutions précédentes, suivez-nous sur Instagram au @nouvellesintimes et abonnez-vous au nouvellesintimes.substack.com. Des commentaires, des questions, une histoire à nous partager? Écrivez-nous au nouvellesintimes@gmail.com.