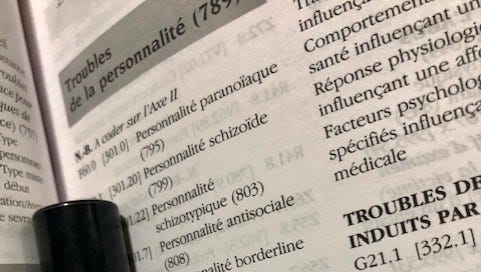Les travailleuses du sexe ne sont pas brainwashées au trauma
«Est-ce que c’est moi qui suis capable de faire ça ou c'est la maladie?»
Par Mélodie Nelson
Plusieurs idées préconçues circulent sur la santé mentale des travailleuses du sexe, comme si c’était plus facile pour les autres femmes de vivre dans une société qui leur vend des rêves en dentelle-qui-pique et en shooters d’échardes.
Si les liens existent entre le travail du sexe et les problèmes de santé mentale, rien n’indique véritablement que le travail les cause ou les amplifie. C’est une industrie accessible pour les personnes qui se sentent incapables de vivre dans un monde de performance rythmée à coups de quarante heures par semaine, sous le regard, les contraintes et les exigences d’une hiérarchie pas toujours bienveillante. Ce n’est pas la solution ultime au mal de vivre, mais ses effets ne sont pas que négatifs et dignes d’un film style fait vécu où tout le monde suffoque dans un bain de lubrifiant.
En quête d’aventures, en lutte contre l’objectification
Anaïs a commencé à danser sur un coup de tête. Elle suppose qu’elle était alors dans une phase de manie. Elle en reconnait les indices : «J’ai été diagnostiquée bipolaire récemment. Quand j’ai décidé de travailler dans un bar, je ne savais pas du tout ce que ça impliquait, mais j’étais super énergique, confiante et en quête d’aventures.»
Elle avait opté pour un bar à deux heures de chez elle. Ses collègues, devenues des amies, ont contribué à son appréciation de cette nouvelle routine, une stabilité «peut-être bizarre» pour d’autres personnes, mais rassurante pour Anaïs. L’une de ses nouvelles amies a été déterminante pour son avenir : «Je savais que je ne serais pas danseuse pour toujours, que c’était une phase transitoire, mais vers quoi, je ne savais pas. Une danseuse très activiste m’a guidée dans ce que c’est, le militantisme et les oppressions.» Dans le bar, sans véritable patron («Il y a un encadrement, mais pas de boss») ni horaire, elle a eu un déclic. Danseuse depuis trois ans, elle étudie présentement en sexologie. Elle y lutte contre le stigma. «Je m’assume. J’en profite pour parler aux autres étudiants de ma maladie et de mon parcours.»
Quand elle a reçu son diagnostic, elle a toutefois remis en question sa profession actuelle. «Je suis quoi, dans ça? Est-ce que c’est moi qui suis capable de faire ça ou c’est la maladie?» Quand la pandémie s’est déclarée, le bar a pris différentes dispositions. «Nous portions des masques. Ça m’a donné encore plus l’impression d’être objectifiée comme un morceau de viande.» Avec l’aide d’une psychologue et d’une sexologue, elle revient régulièrement sur ce qu’elle vit et sur des schémas que le travail a possiblement ancrés en elle. «J’ai besoin de gratification. J’aime me sentir désirée. Mais je veux de l’amour.» Elle tient aussi à souligner qu’elle n’oublie pas d’où elle vient, et que malgré ce qui peut l’atteindre et la troubler dans son travail, elle s’y sent bien.
Pouvoir enfin prendre soin de soi
Devenir danseuse a changé la relation de Naomie avec son corps. «J’ai tellement aimé les sentiments de pouvoir et d’excitation. Je me suis dit que je devais prendre soin de moi et de ma santé pour continuer à faire mon travail de façon valorisante et fructueuse.» Habitée d’une plus grande estime d’elle-même, elle a diminué sa consommation d’alcool, réfléchi à l’influence de ses troubles alimentaires et a appris à s’affirmer, «à dire non».
L’autonomie financière à laquelle accèdent certaines travailleuses réduit considérablement leurs angoisses et insécurités. Pour Charlotte, c’était l’occasion de pouvoir enfin s’offrir une thérapie. «Sauf que le jugement que la société pose sur mon travail, ça affecte ma santé mentale en retour.»
Les cauchemars
Dans l’essai Mais oui c’est un travail! Penser le travail du sexe au-delà de la victimisation, Chris Bruckert et Colette Parent révèlent justement la lourdeur de la stigmatisation, parfois combinée à d’autres éléments comme l’ethnicité, l’appartenance de classe et des idées fausses entretenues, entre autres, par les médias.
«Travailler dans l’industrie du sexe a des conséquences qui s’étendent bien au-delà du milieu de travail. Le stigmate est vécu de façon très concrète par les travailleuses du sexe et plusieurs d’entre elles racontent comment elles doivent composer avec un environnement qui prend prétexte de leur travail pour juger et définir qui elles sont plutôt que de n’y voir qu’une partie de ce qu’elles font. Les travailleuses parlent d’une multitude de situations douloureuses, incluant la perte de la garde de leur enfant, le refus d’embauche lorsque des employeurs potentiels découvrent leur activité actuelle ou passée dans l’industrie du sexe, le rejet par les membres de leur propre famille. (…) La crainte d’être stigmatisée ajoute un niveau supplémentaire de tension dans les vies professionnelles et privées de ces femmes.»
Nolita en faisait des cauchemars. «Tous les calculs qu’impliquaient les mensonges et les secrets que j’avais érigés autour de moi, pour ne pas subir les jugements, ou faire du mal ou de la peine à mes proches, m’ont énormément rongée. J’étais toujours stressée, comme si je devais courir entre deux existences qui ne devaient absolument pas se croiser. C’était rendu invivable.»
Hésitant à quitter l’industrie, Nolita a finalement décidé de s’éloigner des personnes qui ne supportaient pas sa décision d’être travailleuse du sexe. «Depuis, sans les mensonges, je me sens non seulement épanouie dans ma vie personnelle, mais également dans ma vie professionnelle. L’une nourrit l’autre sans incohérences, sans quiproquos. Je me sens beaucoup plus calme et en adéquation avec moi-même.»
Une façon de guérir et d’explorer l’intimité
Cesser d’être escorte a au contraire été la décision de Coralie. «Le travail du sexe m’a sauvée. J’ai eu l’occasion de travailler mes traumas, sans que mes clients s’en rendent compte, de devenir plus confiante. J’ai eu moins de plaisir quand, comme pour toute job, j’ai eu l’impression que je devrais davantage performer, pour l’argent. Je ne l’ai finalement jamais fait. Le lien que j’avais avec ce travail était trop précieux pour que je risque de le gâcher.»
Lila aime aussi la possibilité d’explorer avec ses clients différentes formes de rapports. «Mon travail, en plus de me libérer d’une énorme anxiété autour de l’argent, vient combler une fonction affective et relationnelle de manière extrêmement rassurante.» Enfant, elle avait développé un attachement « évitant», qui fait en sorte qu’il est extrêmement difficile pour elle de se rapprocher intimement de quelqu’un dans sa vie personnelle, sans avoir la sensation d’étouffer ou l’envie de fuir la relation. «Le travail du sexe, à cause du cadre très précis (avec une heure de début, une heure de fin), me permet de développer de l’intimité avec plusieurs personnes, dans un contexte très sécurisant et pas anxiogène. Quand la connexion avec l’autre est très forte, c’est aussi pour moi, comme pour certains clients, l’occasion d’explorer l’intimité qui continue de se développer à travers le temps.»
L’industrie a permis à d’autres travailleuses, comme pour Lila, Coralie et Anaïs, de se retrouver ou de se créer une place, une identité ou des ambitions, à l’extérieur de dictats sociaux ou d’histoires troublantes du passé.
«J’ai été abusée sexuellement par mon premier partenaire sexuel, pendant un an et demi, à quinze ans. J’ai longtemps pensé que je devais servir sexuellement les autres, sans plaisir. Quand j’ai commencé à être sexworker, j’ai réalisé que même si on me payait, c’était moi qui avais le pouvoir sur ma sexualité, qui décidais qui serait mon client ou pas, mes activités professionnelles et mon tarif», affirme Christine. Cette dernière suppose toutefois que passer pour blanche et avoir une famille relativement aisée lui permet de travailler plus facilement. «Je suis consciente de mon privilège», dit celle qui a réalisé, grâce à ses prouesses professionnelles, qu’elle était «le seul et unique maître» de son corps.
Ce texte fait partie de Nouvelles intimes, un espace de liberté et d'exploration de sujets plus tabous en société. Pour ne manquer aucune édition de cette infolettre signée Mélodie Nelson et Natalia Wysocka, et pour lire nos parutions précédentes, abonnez-vous sur nouvellesintimes.substack.com